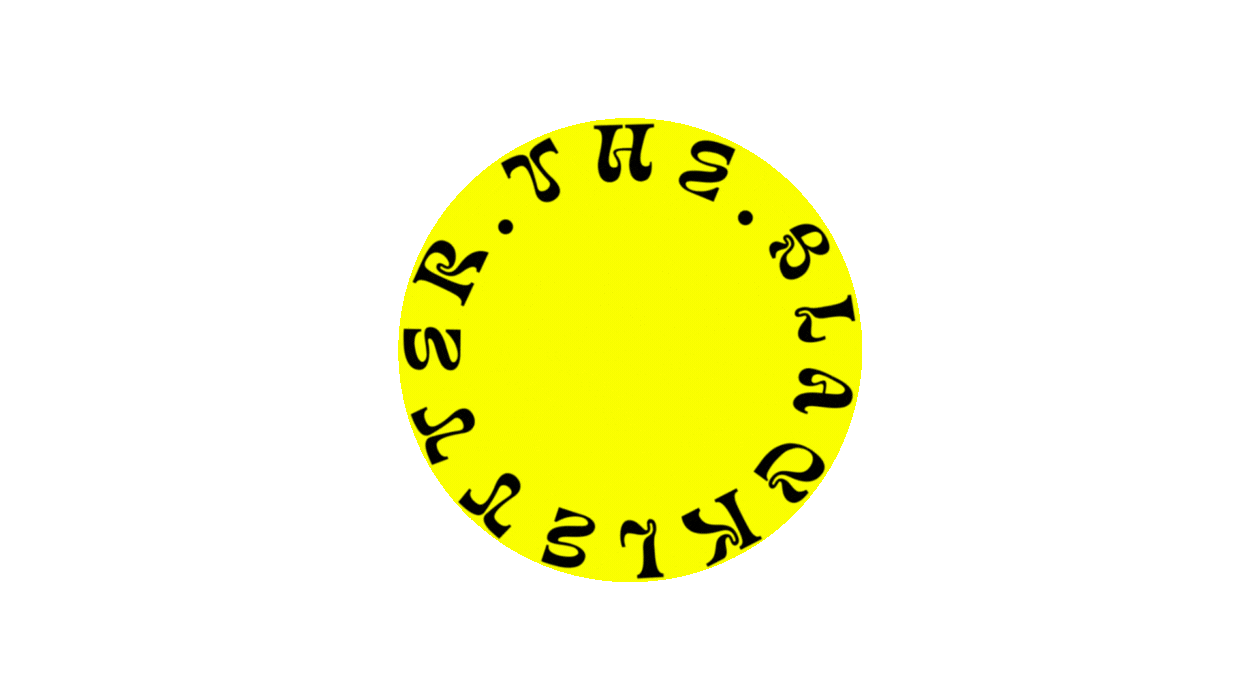Zion : un film guadeloupéen bouleversant entre mémoire, béton et gwoka
Une plongée inédite dans la Guadeloupe contemporaine à travers les yeux de sa jeunesse, ses traditions et ses douleurs.
Samedi soir, je suis allée voir Zion avec mon amie Soraya. Je voulais tout simplement le soutenir, parce que les films réalisés par des Antillais, sur les Antilles, dans les Antilles, sont si rares qu’on y va d’abord par devoir. On veut que ça marche, on veut que ça existe. Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est que le film me bouleverse. Réalisé par Nelson Foix, Zion est tourné à 80% en créole — un acte puissant, une déclaration d’identité. Mais au-delà de la langue, c’est toute la Guadeloupe qui y palpite : ses rues, ses visages, ses paysages, son histoire, sa culture , sa violence, son humour et ses cicatrices.
Ce film m’a fait chaud au cœur, bien plus que par son réalisme, parce qu’il est à nous. Enfin un film où les corps sont familiers, où les silences ont du sens, où les regards ne trichent pas. Zion réussit à faire émerger une mémoire créole à travers des forces symboliques majeures : le gwoka, le carnaval …
Je viens de la Guadeloupe. Et le film m’a fait mal, aussi, il m’a rappelé le meurtre de mon cousin, dans des circonstances très proches de celles évoquées dans le scénario. Le trafic, la débrouille, les impasses sociales. Zion n’a pas peur de poser la réalité crue sur la table : la rareté des opportunités pour les jeunes, le prix de la vie, l’eau polluée, les terres empoisonnées, l’effondrement de toute perspective viable.
C’est un film ancré, pas un récit hors-sol.
Le personnage principal, Chris, interprété avec une intensité effrayante par Sloan Decombes, m’a glacée et souvent énervée tout au long du film. Ces choix, ses prises de decisions sont incomprehensiblement comprehensible. On commence par le prendre pour un pauvre type — un garçon largué, embarqué malgré lui. Puis peu à peu, on s’y attache, malgré les gestes, malgré les violences.
La photographie du film est d’une beauté renversante. Chaque plan semble réfléchi, habité, parfois presque pictural. La musique, elle aussi, donne au film sa chair émotionnelle. Ce n’est pas un enrobage, c’est un moteur narratif. Il y a quelque chose de nerveux, d’organique de même mystique, dans la manière dont la bande-son accompagne la montée en tension.
Les personnages féminins sont en retrait, mais leur présence forme une constellation discrète : la sœur du trafiquant, l’amie fidèle de Chris, la mère de Zion. Elles ne sont pas centrales, mais elles portent, elles soutiennent, elles incarnent ce que la société attend d’elles, ou ce qu’elle refuse de leur donner : soins, fidélité, maternité. Ce n’est pas une critique, mais un constat : les femmes sont là, à la marge, comme souvent dans les récits d’hommes à la dérive.
Le Carnaval, le Gwo-Ka, Klodo et la Résistance Politique à Travers l'Identité Guadeloupéenne
Pour qui connaît la Guadeloupe, Zion est un film truffé de signes qui parlent de la réalité sociale et politique du territoire :
Un tag « Jistis pou Klodo » y apparaît, évoquant l’affaire de Claude Jean-Pierre, décédé à la suite d’une interpellation violente en 2020 durant la période Covid. Son nom a circulé dans les rues et les manifestations sans que justice ne soit rendue. Ce tag est là, dans le film, sans commentaire, comme un murmure de rage adressé aux nôtres, un acte de résistance silencieuse.
Le carnaval, tel qu'il est représenté dans le film, est loin de n'être qu'un folklore. Historiquement, il a été l’un des rares moments où les esclaves pouvaient s’exprimer librement, inverser les rôles, et tourner en dérision leurs oppresseurs. Ce geste de transgression perdure aujourd’hui encore : le carnaval est un lieu de contestation sociale, de satire politique, et d’exubérance réparatrice. Il est donc bien plus qu'une simple festivité dans le film. Il traverse le film comme un souffle populaire, une danse collective où les masques, les tambours et les corps déguisés deviennent un langage à part entière. Le carnaval est ici une affirmation de soi et une résistance joyeuse.
Et puis il y a le gwoka. Plus qu’un simple fond sonore, le gwoka est une colonne vertébrale du film. Le père du personnage principal est joueur de gwoka, et sa mère en est danseuse. Cette filiation, transmise par le tambour et le corps, raconte l’histoire des Antilles sans mots. C’est un héritage qui porte la douleur, la résistance, la joie et le souvenir de l’esclavage. Le gwoka naît dans la nuit des plantations, une musique qui accompagne aussi bien les luttes que les fêtes, qui donne du rythme à ce que l’histoire a voulu faire taire. Dans Zion, le gwoka est un acte de survie culturelle. Il incarne le processus de ré-ancrage identitaire personnifié également par le père qui en est le joueur.
Zion nous rappelle que la mémoire créole n’est pas un livre figé c’est une mémoire orale, musicale, gestuelle, qui passe par le tambour, la moto, la langue, la danse, le déguisement.
Elle ne demande pas la permission pour exister — elle s’impose, parce qu’elle est là.