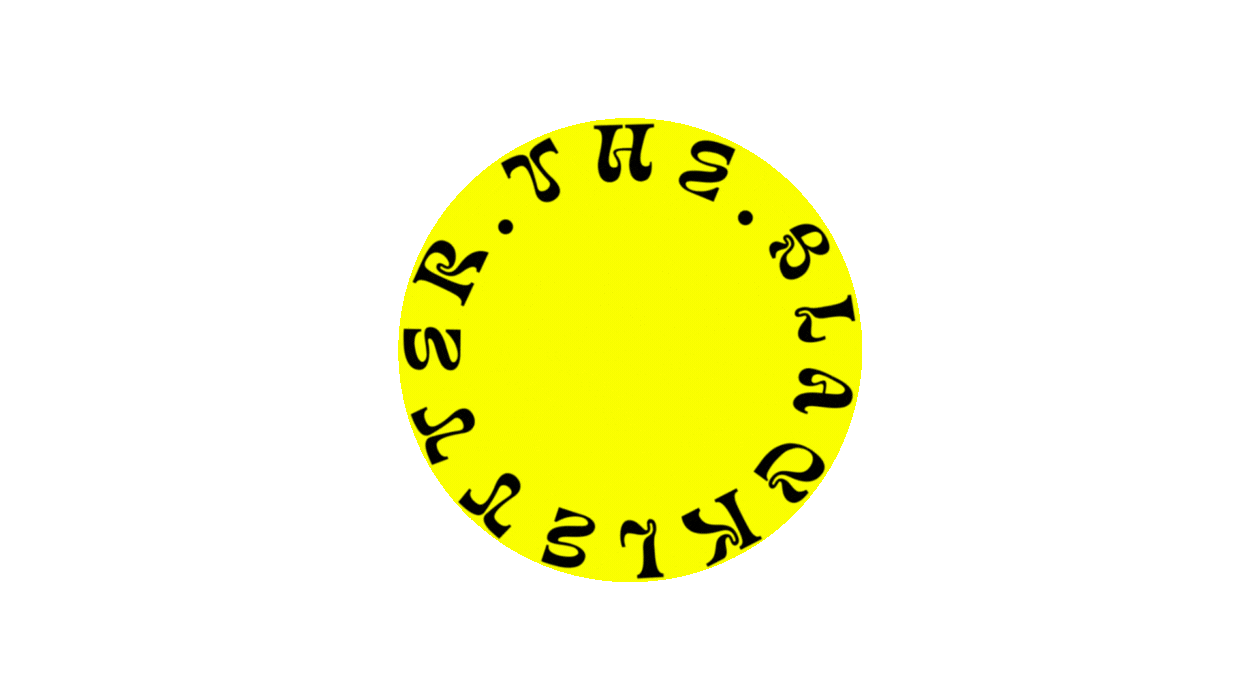"L’Appel au Calme" : Quand le Silence Devient une Arme de l’Oppression
Émeutes : Le Dernier Langage des Invisibles
J’écris ce manifeste car, en tant que femme noire, la colère a toujours été associée à mon image. Cette émotion, pourtant universelle, m’a longtemps été présentée comme un défaut, une menace, une excroissance qu’il fallait dompter. Il y a quelques années, j’ai discuté avec une amie de ce sentiment et de la façon dont je souhaitais canaliser ma colère en action constructive. À l’époque, je n’étais pas encore pleinement consciente que ma rage était déjà une émotion constructive, saine et positive — une énergie vitale parmi tant d’autres qu’on m’avait insidieusement appris à museler.
En grandissant, tout mon être a toujours été perçu comme un problème : trop grande, trop bruyante, trop masculine, trop bavarde, trop séduisante, trop consciente, trop noire. Ce “trop” permanent, qui m’a collé à la peau, n’était rien d’autre qu’un rappel quotidien de la norme blanche et patriarcale à laquelle je devais me plier. On m’apprenait à mettre de l’eau dans mon vin, à rentrer dans le rang, à courber l’échine pour éviter les vagues. Ce n’était pas une invitation à la paix, mais une injonction à l’effacement.
Mes amis, ma famille et mes collègues m’ont souvent critiquée. On me disait : « Tu devrais t’exprimer moins comme ça et plus comme ceci. » Derrière cette remarque, une exigence implicite : celle de rendre ma parole acceptable, c’est-à-dire moins noire, moins féminine, moins libre. J’étais censée mettre les autres à l’aise à mes dépens, me fondre dans la masse et me rapetisser. Cette adaptation constante, que j’ai longtemps confondue avec de la maturité, n’était qu’une forme de survie sociale.
J’ai vite réalisé que ce qui compte le plus, ce n’est pas comment on parle, mais qui parle.
Selon votre ethnie, votre race, votre genre et votre statut social, les gens vous écoutent différemment et attribuent des émotions supposées à votre discours.Même si vous exprimez le même point de vue, avec le même ton qu’une personne blanche, en tant que femme noire, vous serez toujours perçue comme agressive. L’histoire coloniale a façonné ce prisme : notre parole est interprétée à travers des siècles de préjugés et de peur de l’autre.
La caste dominante sera toujours entendue et pourra même se prétendre la voix des sans-voix, tandis que les mots de ceux qui sont réduits au silence seront ignorés. Pourquoi ? Est-ce une question de vocabulaire, de ton, de forme ? Bien sûr que non. Cette logique simple et cruelle permet aux structures de pouvoir de continuer à valoriser certaines voix au détriment d’autres, d’attribuer la raison à certains et l’émotion aux autres, comme si la lucidité appartenait à un seul camp.
Tout cela révèle plutôt une question fondamentale : qui a le droit de parler, d’être entendu, d’exister à travers sa parole ? Qui est reconnu comme un être humain doué de raison et de réflexion ? Le droit à la parole, loin d’être universel, demeure un privilège réservé à ceux dont la voix ne dérange pas.
Je me remémore la phrase de Djamila Ribeiro dans La place de la parole noire : « Who can speak? What happens when we speak? What are we allowed to talk about? » Ces interrogations résonnent encore en moi. Lors d’une énième discussion, on m’a demandé de reformuler ma pensée, jugée trop froide, trop directe. Comme si une femme noire devait toujours adoucir le tranchant de sa lucidité pour être tolérée. C’est alors que j’ai pris conscience de la relation politique, fascinante et sadique à la fois, qui existe entre colère et suprématie blanche.
Une émotion peut-elle être détournée par une idéologie pour se retourner contre celui qui l’exprime ? Manifestement, oui. La colère noire est ainsi perçue non pas comme un cri de justice, mais comme une menace. Et pourtant, cette colère naît du refus d’être invisibilisé, de l’exigence d’exister pleinement.
Toute voix qui s’oppose au capitalisme, au patriarcat ou à la hiérarchie raciale est fréquemment perçue comme une agression. Remettre en question ce système et ses institutions — qu’elles soient judiciaires, éducatives ou policières — est automatiquement assimilé à un acte inapproprié. On nous intime de calmer le jeu, de garder notre sang-froid, comme si l’émotion était un luxe réservé à ceux que la société n’opprime pas. En conséquence, je m’impose de respecter certains codes et un langage strict à chaque prise de parole, de peur que mes propos soient ignorés, mal interprétés ou invisibilisés . Mais soyons lucides : la politique de respectabilité — cette stratégie où les membres d’une communauté marginalisée répriment volontairement certains aspects de leur identité politique et culturelle pour accéder à une meilleure mobilité sociale et gagner l’approbation de la majorité — est un mécanisme d’adaptation profondément destructeur. Fruit d’années d’exploitation et d’exclusion, il engendre des environnements toxiques au sein même de la communauté et maintient la marginalisation. Modifier mon langage, ma posture ou mon esthétique ne suffira jamais à apaiser le capitalisme, car ma simple existence lui apparaît comme une anomalie.
Nos communautés sont systématiquement perçues comme une menace pour l’ordre public. On nous accuse d’être « agressifs » ou « dangereux », nous obligeant à contrôler nos émotions pour ne pas correspondre aux stéréotypes qu’on nous impose. Chaque jour, on nous réprime. Chaque jour, on nous intime de taire notre voix, d’avaler nos cris. Mais que reste-t-il quand on atteint le point de rupture ? N’avons-nous pas le droit de hurler notre rage ? N’avons-nous pas le droit de nous indigner, de pleurer, de crier, de brûler les mots et les murs qui nous enferment ? N’avons-nous pas simplement le droit d’être humains ?La colère est une émotion puissante. Elle peut effrayer, mais elle est aussi l’émotion de la révolution. Exprimer sa colère de manière brute et honnête c’est un acte de résistance contre une politique de domination qui cherche à nous maintenir sans nom et sans voix et c’est un refus de la domestication émotionnelle.